
TROISIEME EXTRAIT
SECTION PREMIERE.
"Sire ce n'est pas tout que d'être roi de France, il faut que la vertu honore votre enfance." Ronsard : De l'Institution pour l'adolescence du Roi très-chrétien Charles IXe de ce nom.
Tel était, sous ce rapport, l’état antique et immémorial des Gaules. Je passe à la domination des Romains. Cette domination ne changea dans aucun des points l’ordre établi. Il est à remarquer que, tout conquérans qu’ils étaient, les Romains évitèrent de s’en arroger le titre ; la Gaule ne fut point regardée dans le principe comme une conquête, mais seulement comme un pays confédéré. Dans la suite des temps, il n’est jamais question que des anciens traités, prisca foedera. Les Gaulois ne sont point appelés les sujets de Rome, mes seulement ses alliés ; socii. Les villes des Gaules se conservent ainsi avec leur sénat, leur milice, leurs lois municipales ; il n’y a de nouveaux que le corps de troupes romaines stationnés ça et là avec leurs commandemens militaires. Il faut ajouter, sous le nom d’indiction et de superindiction, le tribut qu’il fallu payer au vainqueur.
Non seulement les Romains ne prirent point d’ombrage de tout cet ancien régime des Gaules ; ils mirent même du zèle à le protéger. Ils tolérèrent les anciennes diètes générales ; ils allèrent quelque fois jusqu’à les convoquer.
L’ancienne hiérarchie des rangs et l’ancienne distinction des terres ne reçurent pas plus d’altération : on continua à distinguer dans les Gaules des terres libres et terres asservies ; des hommes ingénus et des hommes tributaires. Les justices seigneuriales se conservèrent de même. De grands jurisconsultes ont cru que Justinien, dans ses Novelles, avait consacré le droit de justice comme inhérent à la seigneur rie. Les preuves qu’ils en rapportent ne me paraissent pas décisives ; mais j’ai lieu de croire que rien ne fut changé sur ce point dans l’ancien état des Gaules.
Relativement aux guerres particulières, l’ancien ordre social ne fut pas changé : les cités des Gaules continuèrent à se battre les unes contre les autres, quand cela leur convint ; les Romains ne s’en embarrassèrent en aucune manière. L’établissement des Francs et des autres nations germaines : voilà où commencent les grandes difficultés.
Mais d’abord nous devons observer que les Francs suivirent presqu’en tout l’exemple des Romains. C’est un point qui a été très-bien éclairci par l’abbé Dubos.
Clovis continua à gouverner les Gaules selon les lois gauloises : il conserva le régime particulier des campagnes qui étaient distribués en seigneurs et en colons, il conserva de même le régime particulier des cités, leur sénat, leurs curies, leur milice. Ni le droit, ni le titre de conquérant ne se montrèrent. Celui qui fut roi des Francs ne fut pour les Gaules qu’un Patrice, ou un consul romain. Ce prince accepta avec beaucoup d’empressement ces deux titres, qui lui furent déférés par l’empereur Anastase : il parait qu’il y attacha plus de prix qu’à son titre de roi.
On ne peut douter de ces égards des Francs pour les Gaulois. Après la destitution de Childérich, la couronne fut donnée non à un Franc mais à un Gaulois. Un Gaulois est fait duc de Melun sous Clovis ; ce Gaulois est en même temps premier ministre de ce prince et son ambassadeur. Enfin les Gaulois sont appelés à toutes les charges du royaume ; on en trouve dans la loi salique faisant partie de la cour du monarque, et désignés sous le nom de convives du roi.
Le même respect est porté aux institutions ; et d’bord c’est la même hiérarchie des propriétés. La loi salique fait mention d’un ordre des terres assujetties au tribut, et appelées pour cette raison tributaires ; elle fait mention aussi d’un ordre des terres franches et allodiales, et appelées pour cette raison alleu. On y trouve le même ordre correspondant de personnes : le Gaulois possesseur, c'est-à-dire celui qui possède ses terres en propre, et le Gaulois tributaire, c'est-à-dire celui qui possède ses terres à la condition du tribut.
Les justices seigneuriales ne reçoivent pas plus d’altération ; il est fait mention de ces justices dans la loi des ripuaires ; elles sont rappelées expressément au concile de Paris, en 615. Il en est de même des guerres particulières. On voit sous la domination des rois mérovingiens, ainsi que sous celle des Romains, diverses cités gauloises se déclarer la guerre. On voit dans les Formules de Marcoule, de la même manière que dans les Commentaires de César, les grands seigneurs se faire accompagner d’une escorte guerrière.
Il semble, d’après ce qui vient d’être dit, que les Francs conservèrent en s’établissant tout l’ancien régime des Gaules ; et néanmoins nous allons voir peu à peu ce régime se modifier en plusieurs points et s’altérer.
Il ne faut pas oublier qu’en arrivant dans les Gaules, les Francs y portèrent des lois, des mœurs, un langage même qui leur était propre : or ; tout en respectant l’ancien régime des Gaules, comme ils ne voulurent point abandonner le leur, il dut y avoir, pendant quelque temps, à plusieurs égards, comme deux régimes divers : l’un tenant à l’ancienne constitution des Gaules ; l’autre appartenant à la nouvelle nation qui s’était établie. Ces deux régimes mis en présence l’un de l’autre durent s’embarrasser quelquefois : peu à peu ils se mêlèrent ; ils finirent par se confondre.
C’est ce que nous attestent nos anciens monumens. Ils nous présentent trois âges distincts. Le premier, celui où les divers peuples sont en présence les uns des autres, et demeurent séparés ; le second, celui où les divers peuples commencent à se fondre ensemble et à s’amalgamer ; le troisième, celui où on voit de cette fusion même de cet amalgame se produire un nouvel état social… A suivre.
Comte de Montlosier : (De la Monarchie Tome 1)






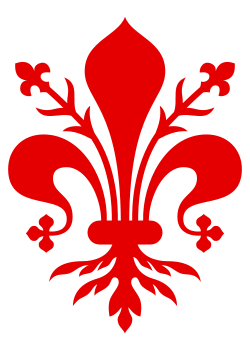
/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_be39e9_1000027932.jpg)
/image%2F1006838%2F20240422%2Fob_9419a1_1000028351.jpg)
/image%2F1006838%2F20240110%2Fob_1be104_lcl101011401-001.jpg)
/image%2F1006838%2F20231025%2Fob_090c16_picsart-23-10-23-19-43-32-368.jpg)
/image%2F1006838%2F20230923%2Fob_cab313_lupin-opportun-1.jpg)
/image%2F1006838%2F20230913%2Fob_4eb839_lcl101014401.jpg)